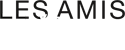Lucide et visionnaire, quand Yves Navarre dénonçait la faillite des démocraties
- Tipota
- Juin, 01, 2020
- Citations, Recherches & travaux
- Commentaires fermés sur Lucide et visionnaire, quand Yves Navarre dénonçait la faillite des démocraties
En ces temps de pandémie mondiale de Covid-19, on tend à rappeler les films et les romans qui, il y a dix, vingt ou cinquante ans, décrivaient un monde allant vers sa fin, ou envisageaient des scènes d’apocalypse. Citées comme des avertissements qui n’ont pas été entendus ou suffisamment compris, ces œuvres culturelles résonnent tout autrement aujourd’hui, une fois disséquées à la lumière de l’actualité. Sylvie Lannegrand nous livre ses commentaires sur les écrits les plus éloquents d’Yves Navarre qui publia plusieurs récits d’anticipation et porta un regard inquiet sur le monde et son évolution.

Des Loukoums à ‘Drummond’, les récits prophétiques d’Yves Navarre
Dans ses écrits, Yves Navarre a souvent commenté son temps et fait part de son effroi devant les abus de notre société. La régularité de ses commentaires est telle que l’on peut parler d’un thème dominant, qui reflète sa sensibilité et définit en partie son imaginaire. À l’acuité du regard sur les événements de son époque s’ajoute, dans certains textes, l’anticipation d’une société dont les excès trouvent leur origine dans le monde contemporain. Plusieurs de ses ouvrages ont une dimension prophétique.
C’est le cas, en particulier, des Loukoums (Flammarion, 1973), l’un de ses romans les plus connus et les plus souvent cités, qui annonce dès 1971 les ravages du Sida. Nous y découvrons le destin de Rasky, l’un des trois protagonistes, dont le corps vieillissant rongé par la syphilis se décompose peu à peu dans la chambre d’hôpital d’un New York sordide, « prison de rectitude, prison verticale, cercueils plus grands les uns que les autres. » À la maladie de Rasky « grignoté » par Dame Syphy répond l’enfer d’une ville où pullulent les insectes, symbole d’un mal qui se propage inéluctablement dans une ambiance de fin du monde.
‘Drummond’, récit d’anticipation, mérite une mention toute particulière. Il figure dans un ouvrage intitulé Romans, un roman, publié par Albin Michel en 1988, mais il fut écrit bien plus tôt et trouve son origine dans une nouvelle rédigée à la fin des années 60. Il s’agit d’un récit futuriste, « roman de science-fiction » comme le qualifie l’auteur dans Biographie, qui dépeint un monde où, subitement, naissent des êtres sans sexe, les drummonds. Number One, premier de sa lignée, est leur chef de file. Cette « fin de siècle inattendue » met l’humanité face à son extinction prochaine et à une « catastrophe internationale » dont le docteur Donnovan, dit Doc, est chargé d’écrire l’histoire. Dans son livre, Doc témoigne d’une société arrivée à épuisement, incapable de relever les défis qui l’assaillent, d’un « monde qui a grandi trop vite, n’importe comment, qui sait tout et qui ne sait rien du tout, qui du haut de sa science ne sait plus que faire » (p.144). Certains passages dénoncent ce qui pourrait tout aussi bien se rapporter à notre société :
Les drummonds firent donc leur apparition sur Terre à un moment de grand amorphisme, de terrible ambiguïté sociale, le pouvoir, dans tous les pays du monde, confrontait des élites dirigeantes à des masses asservies, il n’y avait que conflits entre les deux partis. Les impérialismes et les mainmises étaient les mêmes partout. La Terre était gouvernée par de braves leaders, qui avaient pour point commun le vague et mol espoir d’un mieux-vivre. Seule l’imprécision de leurs convictions leur permettait de continuer à diriger, de ne pas être assassinés dans les abattoirs des rues en liesse, ou bien proprement dans un avion officiel, ou encore avec la complicité de polices secrètes. (p.147)
« Les hommes de science, eux, en profitèrent pour ravir le pouvoir, supplanter les politiciens, mettre les économistes à leur botte. »
Par-delà le fil anecdotique qui développe l’intrigue à travers le personnage de Doc, l’humanité au temps fictif des drummonds nous renvoie le miroir grossissant de ce que nous vivons, entre autres l’apathie générée par le traitement médiatique d’événements tragiques auxquels les citoyens deviennent insensibles :
L’humanité cette année-là était arrivée au degré absolu de pollution et d’indifférence. Elle ne se sentait même plus concernée par les grandes catastrophes, les villes qui sombraient, les avions géants qui s’écrasaient, les tremblements de terre qui faisaient des dizaines de milliers de morts et les famines de centaines de milliers, c’était devenu normal, les drames ne faisaient plus que la manchette d’un jour, l’événement d’un journal parlé, l’objet d’un reportage, un soir, le lendemain réservait la surprise d’autres nouvelles sanglantes, on passait aux suivantes. Ainsi de suite. L’ennui. L’humanité, sexuée, s’ennuyait. Elle se gavait de drames qui, pour elle, n’avaient plus rien de dramatique. (p.152)

L’auteur décrit les mécanismes à l’œuvre dans l’avènement de cette nouvelle étape de notre civilisation. Ses évocations sont parfois d’une actualité saisissante. Tactiques politiciennes, réactions du monde scientifique et rivalités de ses représentants, discours moralisateurs, endormissement des citoyens, mouvements collectifs de panique revêtent une dimension prophétique. Un exemple parmi de nombreux autres :
Dans un monde habitué au ravitaillement quotidien de drames et de nouvelles sensationnelles, le phénomène drummondien prit possession de l’avant-scène. (…) Les hommes d’esprit le comprirent tout de suite. Les hommes de science, eux, en profitèrent pour ravir le pouvoir, supplanter les politiciens, mettre les économistes à leur botte. Il s’agissait, une fois pour toutes, de démontrer la suprématie de la science : on trouverait l’origine du mal et on la combattrait, le monde se retrouverait comme avant, injuste mais allant, déchiré mais puissant. On entendit un beau concert de promesses. On pouvait lire, chaque jour, dans les journaux des manchettes retentissantes, Victoire pour bientôt, De nouveaux germes miraculeux mis au point par un savant australien, La C.I.G. affirme dans un communiqué : nous avons fait un grand pas en avant. La science piétinait. (p.159)
Les mesures drastiques censées sauver l’humanité comprennent les actions du gouvernement en place pour éradiquer les drummonds et faire en sorte que les femmes ne soient plus en mesure de procréer. Les opérations des « milices sanitaires » s’accompagnent d’une recrudescence des espèces animales, signes d’un regain de vie du monde naturel au moment où l’espèce humaine est en voie d’extinction. « Le monde avait quelque chose d’urgent et de grave à dire. » (p.163). Cette évocation futuriste d’une société à la fois étrange et effrayante tourne à une vision cauchemardesque :
Les sages, ceux qui ne croyaient en rien et surtout pas à la science, se contentèrent de ne plus acheter de journaux et de magazines, de ne plus rien écouter et de ne plus rien voir. Ils mirent leurs télévisions et leurs radios à la cave, avec les souris et les rats qui pullulaient. (…) Certains d’entre eux publièrent même des méthodes d’isolement pour fuir l’exploitation qui se faisait de l’actualité. Ils furent des milliers à se crever les tympans, à s’arracher les yeux, des milliers à devenir fous. On les liquida proprement.
(…) (p.163)
Autre thème de ce roman : l’escalade de la violence et de l’horreur, qui culmine avec la décision d’exterminer les drummonds par des milices et des chasseurs dont les efforts s’avèrent totalement inefficaces, tout comme achoppent les expérimentations des généticiens sur des cobayes volontaires. Autant d’échecs répétés qui aboutissent à une guerre fratricide et à des représailles impitoyables et sanglantes de la part des drummonds.
Doc, dernier représentant des êtres sexués, esprit curieux hanté par le désir de comprendre, épris d’écriture, cherche à percer la signification des temps étranges que traverse l’humanité, mais « Qui s’était recueilli un instant, avait essayé de saisir l’illogisme des actions menées pour ramener tout à une normalité ? » (p.198). Les êtres sexués se révèlent incapables de faire face à une situation inédite, ayant « été habitués à se sentir omnipotents en toutes disciplines, sûrs d’un pouvoir qu’ils croyaient illimité, fous et fiers des découvertes de leur vingtième siècle. L’erreur venait de la logique de leur confiance en eux-mêmes. » (p.211) Number One livre à Doc son interprétation de la fin de l’humanité et d’une « Terre nettoyée, abandonnée à elle-même » (p.225) : « Vous avez usé et abusé de votre trop grande beauté, et du don qui vous avait été donné de vous reproduire. Vous reproduire revenait à vous détruire et à détruire. » (p.224)
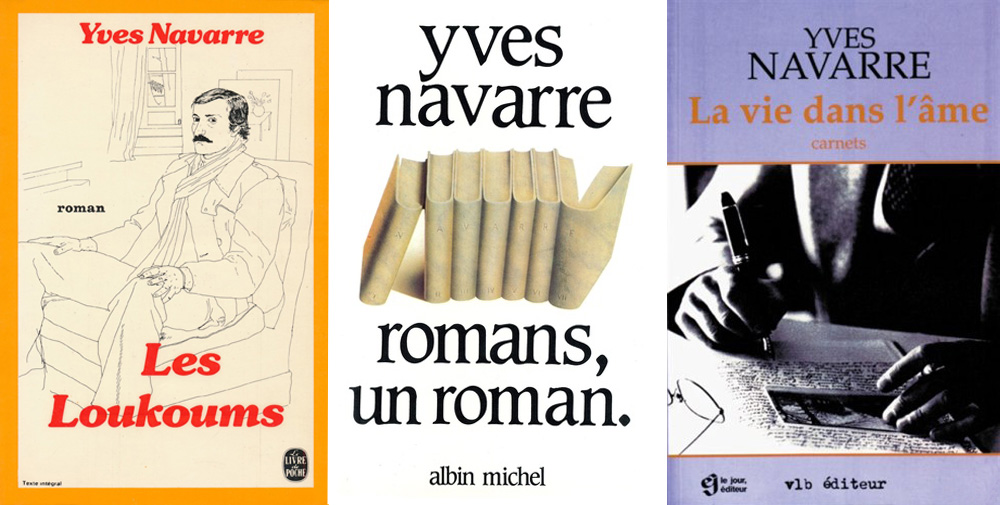
Le désarroi d’Yves Navarre face à la marche du monde
Plusieurs autres ouvrages d’Yves Navarre expriment une profonde inquiétude, voire un désarroi, quant à la société de son temps. Il s’agit soit de fictions qui englobent le commentaire social dans le fil de la narration (c’est le cas, par exemple, de Dernier dimanche avant la fin du siècle, Flammarion, 1994) soit d’ouvrages qui permettent à l’auteur d’exprimer librement son point de vue sur la marche du monde (comme les chroniques de La Vie dans l’âme, VLB, 1992, ou le texte hybride, mi-roman mi-journal, de La Terrasse des audiences au moment de l’adieu, Leméac, 1990).
Une frayeur face à la marche du monde habite le protagoniste de Dernier dimanche avant la fin du siècle, plus encore peut-être que son passé ou la douleur de savoir son amant, Yulen, emprisonné à Fort Detrick : « L’euphorie de juste après Mai 68 qui régnait alors à Paris, comme dans le monde, lui inspirait un sentiment de frayeur aussi prégnant que celui de ses amours (…) » (p.16) Dans ce roman publié à titre posthume en 1994, John O’Flaghan, dit John Yard, tente vainement d’échapper au désarroi qui l’étreint. Ses amitiés, ses connaissances et sa brillante carrière de concepteur d’emballages et de flacons pour l’industrie du luxe, ne parviennent pas à réprimer le tourment qui le hante « dans un monde qui appelle la chute » (p.108), « aussi généreux que cupide et dont (…) il se disait qu’il courait à sa perte très exactement comme il avait été l’artisan de sa gloire ». John ne parvient pas à « faire comme si rien ne menaçait, et comme si le pouvoir et ses gabegies avaient encore des raisons d’être disputés » (p.42).
Il est intéressant de voir comment l’auteur incorpore au texte de fiction des éléments de l’actualité, en particulier avec Fort Detrick, lieu réel du Maryland, centre de recherche biologique américain intégré à l’intrigue et commenté dans un épilogue dont voici quelques extraits :
Où il aurait été question de ce secteur de Fort Detrick à l’usage de la NASA et où l’on mettait en quarantaine les cosmonautes au retour de leurs missions, devenues habituelles, pour voir s’ils ne rapportaient pas de l’espace de précieuses bactéries qui auraient pu ; d’une part être analysées pour l’instruction ; d’autre part être utilisées pour la destruction, arme bactériologique. (…) ladite section de Fort Detrick ayant été désaffectée, faute de voyageurs de l’espace, et à cause de toutes les crises et restrictions, de tous les fanatismes et nationalismes ressurgis, puis réaffectée à l’usage, également militaire, de mise au point de virus pouvant décimer un hypothétique ennemi.
Où il aurait été narré que contre la promesse d’une libération sans aucune condition, sept prisonniers à vie des autres blocs du Fort avaient accepté de servir de cobayes pour l’expérimentation de l’effet d’un virus qui n’avait de nom qu’un code tenu secret. (p.174)
(…) Ainsi Yulen distribua le virus qui n’avait pas tout de suite fait effet sur lui et ses six compagnons détenus.
(…) Avec scrupule on venait de créer le marché du siècle à sa fin, un mal comme un autre, sauf qu’il touchait à l’étreinte de certains, puis de tous, et qu’il y aurait pandémie, donc indifférence en rempart et de nouveaux fonctionnaires pour lutter, prôner, chercher une multitude d’autres cobayes, en parlant de « nouvelle Résistance ».
(…) Où le texte aurait été décapité par peur de la suite (…) (p.173-176)
Une profonde lassitude se dégage de ce livre publié à titre posthume en 1994, quelques mois après le suicide de l’auteur. L’épilogue et la citation qui clôt l’ouvrage traduisent tout autant l’urgence d’un apaisement que son impossibilité. La dernière phrase des notations placées après l’épilogue réitère le sentiment d’angoisse qui, peut-être, contribua au lâcher-prise d’Yves Navarre : « L’actualité l’effrayait ».
La Terrasse des audiences au moment de l’adieu, écrit au moment du départ pour le Canada et publié en 1990, est un texte mixte dans lequel domine la forme du journal personnel. On y trouve, entre autres, de nombreux passages sur les états d’âme de l’auteur et des commentaires sur son quotidien et ses rencontres. Le chapitre 46, « L’effondrement du grand balcon de l’Occident », débute par quelques anecdotes et par l’évocation de la visite au Président Mitterrand, dont Yves Navarre était proche. Suit un long texte à la troisième personne, qui explique le titre donné au chapitre et traduit surtout l’état d’esprit de l’auteur au moment de quitter Paris pour Montréal. En voici quelques extraits :
 Il décida de dire « il » en exprimant sa propre pensée. Peut-être alors lui reprocherait-on moins de donner de son époque et de sa société une image sombre et désenchantée. Une terreur régnait. Le message était urgent. (…) Il tenterait l’impossible, dire l’effondrement du grand balcon de l’Occident, avec un O majuscule et un incident de mot qui eût pu faire penser à un Accident, simple coquille d’imprimerie, un o qui deviendrait un a. (…) Il eût pu renoncer à l’entreprise s’il n’avait eu de la hargne, de la ténacité. Sa volonté de se supprimer n’avait toujours eu d’égale que son instinct de conservation. Le siècle courait à sa fin et c’était vraiment une fin de siècle. (…) Il avait, ici et là, si souvent entendu que le fascisme ne passerait pas. Celui-ci passait ouvertement, cruellement, comme inévitablement. Il passait subrepticement, ni vu ni connu, pis encore, le fascisme du faire dire, du faire penser, du faire croire. (…) Le monde l’obsédait, l’histoire en cours. (p.223-224)
Il décida de dire « il » en exprimant sa propre pensée. Peut-être alors lui reprocherait-on moins de donner de son époque et de sa société une image sombre et désenchantée. Une terreur régnait. Le message était urgent. (…) Il tenterait l’impossible, dire l’effondrement du grand balcon de l’Occident, avec un O majuscule et un incident de mot qui eût pu faire penser à un Accident, simple coquille d’imprimerie, un o qui deviendrait un a. (…) Il eût pu renoncer à l’entreprise s’il n’avait eu de la hargne, de la ténacité. Sa volonté de se supprimer n’avait toujours eu d’égale que son instinct de conservation. Le siècle courait à sa fin et c’était vraiment une fin de siècle. (…) Il avait, ici et là, si souvent entendu que le fascisme ne passerait pas. Celui-ci passait ouvertement, cruellement, comme inévitablement. Il passait subrepticement, ni vu ni connu, pis encore, le fascisme du faire dire, du faire penser, du faire croire. (…) Le monde l’obsédait, l’histoire en cours. (p.223-224)
L’image du balcon, présente dans d’autres ouvrages, prend ici un relief particulier par la signification qui lui est conférée et l’élaboration du commentaire qui gagne en précision et en intensité au fil des pages, avec des références à l’histoire, à la vie culturelle, à la politique européenne, à l’environnement :
Tout avait commencé à se lézarder du côté de Berlin. (…) Tout s’était clairement fissuré de la Baltique à la Méditerranée. Une fissure, d’abord, ça ne se voit pas, ça n’a pas beaucoup d’importance. Et petit à petit, ça s’ouvre, ça se creuse, on y est habitué et on fait comme avant, on continue. (…) L’Occident entier applaudissait au spectacle de sa fin alors que la faim gagnait du terrain partout dans le monde, la soif et même le savoir. (…) Au grand balcon de l’Occident, tous se croient les tenanciers du monde entier. Bientôt on importera de l’eau comme on importe du pétrole. C’est important l’eau. Bientôt, il n’y en aura plus. On le sait, on continue. Même le ciel a changé, les salades ne sont plus les mêmes, un vent d’est a soufflé, on le sait, on continue. Un arbre, aussi, c’est beau. Et l’herbe, l’odeur de l’herbe ? Tout est râpé, rongé. D’où vient la maladie de l’orme ? On le sait, on s’en fout, on fait comme si, on continue (…). Il y allait de l’homme comme de l’eau et des forêts, pour ne citer qu’elles. Tout était prévu, su, connu, évident. La loi était désormais chacun pour soi, coda. Il ne voulait ni ne pouvait l’admettre. À la longue, les vaines promesses politiciennes avaient fait leur effet. Le temps était passé. Tout allait s’effondrer. L’orgueil de l’Occident n’était plus que vanité. (p.227-229)
« C’est à croire que le monde entier souhaite le carnage. La politique inclut-elle toujours, ne serait-ce qu’un peu, la morale ? »
Dans les chroniques de La Vie dans l’âme, l’auteur exprime son opinion personnelle sur l’actualité en cours, non seulement celle du Québec où il vit à ce moment-là, mais celle du monde entier, au gré des nouvelles. Les Carnets qui composent le recueil (et qui, à l’origine, furent publiés chaque semaine dans Le Devoir sous la forme d’une colonne hebdomadaire) concernent l’actualité culturelle et politique, « l’Histoire en cours », des anecdotes du quotidien, des textes libres sur des sujets personnels, le courrier reçu, de courts textes de fiction, etc. Les passages récurrents sur l’actualité laissent transparaître une conscience souffrante révoltée par les drames qui se déroulent aux quatre coins du monde, alliée à un vif sentiment d’impuissance : « Nous sommes allés trop loin. » (Carnet 9, p.52). Au début Carnet 11, l’auteur réagit comme suit aux nouvelles sur la Guerre du Golfe :
Est-ce possible ? Suis-je branché sur une fréquence de radio qui n’annonce que des horreurs ? Ou bien est-ce un signe des temps, les lourdes portes du siècle vont se refermer, on va s’y broyer les doigts. N’ai-je pas entendu ce matin, aux « informations », qu’une certaine puissance en place, elle aussi, dans le Golfe, avait d’ores et déjà « commandé 800 sacs pour le rapatriement des corps ». Pourquoi 800 ? Du calcul de probabilité ? L’intendance, en général, suit, et voilà qu’elle précède. (…) Il y a des marchands de sacs à corps humains comme il y a des marchands de sacs à skis, même matière, même principe, plastique et fermeture à glissière. La commande d’un seul sac à soldat eût été de trop. C’est à croire que le monde entier souhaite le carnage. La politique inclut-elle toujours, ne serait-ce qu’un peu, la morale ? (p.59)
L’auteur revient un peu plus loin sur le sujet, après avoir fait un détour par d’autres réflexions, comme y invite la forme libre de la chronique. Le commentaire s’élargit à l’absurde de toutes les guerres : « on jase de désarmement, de paix, tout en fomentant une belle-bonne guerre, bien sanguinaire, où des soldats seront tués par des armes que leur pays, d’une manière ou d’une autre, a vendues à l’ennemi. On voudrait taire cela et se terrer. » (p.61) Les autres Carnets sont aussi égrenés de remarques sur l’actualité, souvent ponctuées par des phrases qui s’apparentent parfois à des aphorismes : « Les chemins vers les démocraties sont de plus en plus difficiles. » (p.64) ; « Floués, les citoyens de cette fin de siècle ne peuvent qu’aller vers des illusions. » (p.64) C’est bien une vision désenchantée qui se dégage de tels passages, vision qui débouche sur un désespoir que l’auteur a du mal à nommer :
 (…) l’actualité du monde entier fait naître en moi non le désespoir en vogue dans les années 50, mais un inespoir qui reste encore à définir. Comment peut-on à ce point brader le monde, truquer et manipuler les sondages et les scrutins, faire la parade du vide avec des commissions de ceci, des commissions de cela, tout prévoir, tout était prévisible et le résultat n’est même pas grotesque ou risible. (Carnet 12, p.64-65)
(…) l’actualité du monde entier fait naître en moi non le désespoir en vogue dans les années 50, mais un inespoir qui reste encore à définir. Comment peut-on à ce point brader le monde, truquer et manipuler les sondages et les scrutins, faire la parade du vide avec des commissions de ceci, des commissions de cela, tout prévoir, tout était prévisible et le résultat n’est même pas grotesque ou risible. (Carnet 12, p.64-65)
Le terme d’« inespoir » est repris dans le Carnet 14 où il est question de « l’inespoir qu’inspirent une actualité fédérale et un capotage international » (p.72). Un long paragraphe sur l’international se termine par deux courtes phrases : « Qui a tué des milliers de Kurdes ? Et comment ? J’ai le cœur en éclats » (p.73) Un autre Carnet dénonce « la dérive inquiétante à tendance totalitaire » (p.116). Les commentaires atteignent un crescendo dans le Carnet 23 où de courts paragraphes (pas moins de dix-huit) se succèdent, chacun sur un sujet précis ayant trait à l’actualité du monde, énumération qui donne le vertige par l’accumulation et la répétition d’une expression à légères variantes : « Où il sera dit… », « Où il sera suggéré… », « Où il sera clamé… », « Où il sera rappelé… », etc. Citons ces deux passages :
Où, quotidiennement, il nous est donné de voir ce qu’il était humainement impossible d’imaginer. L’inhumain possible est à la forge des grands de ce monde. On s’arrache déjà les marchés de reconstruction de ce que l’on détruit. Les famines, les forêts, les migrations on s’en contre-claque. Ne sommes-nous pas en train de fuir l’Histoire ? (p.118)
Nous étions tant (trop ?) prévenus ; nous avions tant (trop ?) prévu ; nous savions tant (trop ?) où nous menait la superbe de la science. Et même ici, loin, si loin, les regards ne sont plus les mêmes, tout comme par un sida, les baisers ont changé, l’amour et le recours aux gestes les plus simples. (p.120)
Constante des Carnets, les observations et les déclarations de l’auteur sur l’actualité dénotent une profonde lassitude et une vive inquiétude face à l’avenir et à la capacité de l’humanité à se reconstruire. Les moments de doute (« Le paysage de ruines est en nous » p.127) s’estompent parfois à la faveur d’une lueur d’espoir (« on ne capitule pas » p.128). Mais celle-ci ne dure guère (« Quel jeu se joue dont nous ne sommes que des pions ? » p.139). Pourtant, le titre du recueil est bien La Vie dans l’âme, signe d’une volonté de poursuivre et de croire encore, comme « témoin du temps, arpenteur de cette fin de siècle » (p.153). Yves Navarre aurait très certainement écrit sur l’époque actuelle : roman, nouvelle, chronique, livre d’anticipation… nul doute que son écriture aurait été inspirée par les temps que nous traversons.
NDLR : retrouvez tous les ouvrages d’Yves Navarre cités dans cet article dans le tableau des œuvres sur ce site.
Articles récents
Archives
- février 2025
- janvier 2025
- décembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024
- juin 2024
- mai 2024
- avril 2024
- mars 2024
- février 2024
- janvier 2024
- octobre 2023
- septembre 2023
- juillet 2023
- juin 2023
- mai 2023
- mars 2023
- février 2023
- janvier 2023
- novembre 2022
- octobre 2022
- juillet 2022
- juin 2022
- mai 2022
- avril 2022
- mars 2022
- février 2022
- janvier 2022
- novembre 2021
- septembre 2021
- juillet 2021
- juin 2021
- mai 2021
- avril 2021
- mars 2021
- février 2021
- janvier 2021
- décembre 2020
- novembre 2020
- octobre 2020
- septembre 2020
- juin 2020
- mai 2020
- avril 2020
- mars 2020
- février 2020
- janvier 2020
- novembre 2019
- octobre 2019
- septembre 2019
- août 2019
- juillet 2019
- juin 2019
- mai 2019
- avril 2019
- mars 2019
- février 2019
- décembre 2018
- novembre 2018
- octobre 2018
- juillet 2018
- juin 2018
- mai 2018
- avril 2018
- mars 2018
- janvier 2018
- novembre 2017
- octobre 2017
- septembre 2017
- juin 2017
- mai 2017
- avril 2017
- mars 2017
- février 2017
- janvier 2017
- décembre 2016
- novembre 2016
- octobre 2016
- septembre 2016
- juillet 2016
- juin 2016